L’un des intérêts majeurs de ce recueil d’articles est d’exposer certaines problématiques centrales en épistémologie sociale.
La première partie de l’ouvrage, composée de textes de Goldman, de Boghossian et de Fricker est celle dont l’unité est la moins apparente. Dans le premier article du recueil, Goldman expose la distinction entre trois formes d’épistémologie sociale. La première, que l’on peut qualifier d’ »interpersonnelle » se concentre sur le statut normatif des croyances et des jugements que forment les agents cognitifs individuels à travers leurs interactions sociales et s’interroge, principalement, sur la manière dont ces derniers doivent répondre aux différents types de preuves sociales : en quoi, par exemple, le fait que certaines données soient socialement transmises affecte-t-il le degré de justification des croyances qui sont censées en découler ?
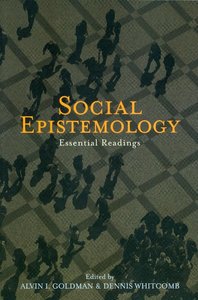
La seconde forme d’épistémologie sociale porte sur le comportement doxastique des agents collectifs et concerne la manière dont les croyances des entités collectives doivent se former. En quel sens peut-on, par exemple, affirmer que la position d’un parti politique sur tel sujet donné est épistémiquement rationnelle ou irrationnelle ? Les propriétés (et, donc, les critères d’évaluation) épistémiques propres aux états mentaux supposés des entités collectives sont-elles identiques à celles qui caractérisent les états des sujets individuels ? On peut toutefois s’interroger sur les limites de ce type d’épistémologie. Si l’épistémologie sociale collective présuppose que certains groupes sociaux peuvent prétendre au statut de sujet épistémique et se voir attribuer des états propositionnels (voire même des capacités méta-propositionnelles) au sens strict, on peut naturellement s’interroger sur les critères qui permettent d’identifier ces entités comme des sujets cognitifs. Si l’on comprend en quoi il peut être pertinent d’attribuer une forme d’intentionnalité à un comité, un jury, voire même à un parti, en est-il de même pour les citoyens d’un même Etat, voire pour un groupe d’individus assis à une terrasse – quand bien même tous, à un certain moment, entretiendraient simultanément des croyances dont le contenu propositionnel est identique ?
Enfin, l’ »épistémologie sociale systémique » porte sur l’évaluation épistémique des systèmes sociaux (dont certains comme la science ou l’éducation ont pour finalité explicite de produire des jugements vrais) ainsi que sur la manière dont ces derniers influent sur les croyances des individus. Les textes du dernier chapitre de ce recueil fourniront l’occasion d’une illustration de ce type de problématique. Remarquons, toutefois, que ces domaines se croisent et peuvent constituer diverses approches d’une même réalité : on peut s’intéresser, successivement, à la manière dont certains individus collaborent au sein de telle institution sociale spécifique et aux effets épistémiques liés à la structure de cette collaboration, à la façon dont ces mêmes individus peuvent s’engager à soutenir des positions en tant que membres de l’institution en question (cette dernière étant alors considérée comme « porteuse » d’états mentaux qui lui reviennent en propre) et, enfin, au fait que ces positions collectives influent en retour sur leurs propres croyances personnelles. Ainsi Gilbert1 a-t-elle, dans un article fameux, réfléchi sur l’incidence des croyances collectives qu’adopte une communauté scientifique sur les croyances individuelles des membres de la communauté en question, en montrant comment l’engagement collectif à affirmer la vérité de tel contenu pouvait entraver toute forme de réflexion indépendante et autonome.
Le texte de Boghossian (chapitre 2) expose un problème très différent : existe-t-il une forme d’incommensurabilité épistémique entre les principes de justification que peuvent adopter différentes communautés ? On peut, en effet, à première vue penser que différentes sociétés ou communautés obéissent à des normes cognitives diverses. Par-delà le constat de la diversité des contenus auxquels adhèrent les individus appartenant à ces différentes communautés, on peut imaginer qu’une différence existe également entre lesprincipes épistémiques qu’adoptent les membres de chaque communauté : le conflit latent ne porterait pas sur telle croyance que p ou que q mais sur ce qui peut constituer une donnée ou une raison en faveur de la croyance que p ou que q -et donc sur ce que l’on doitcroire en telle situation. Cette différence concerne des croyances normatives (puisqu’elles portent sur la légitimité de notre comportement doxastique) et souvent implicites car elles sont rarement thématisées – quoi que les conflits épistémiques puissent constituer des occasions d’explicitation.
Lorsque de tels conflits (ou discussions) ont lieu, il ne s’agit pas, dès lors, de savoir s’il est légitime de croire que tel fait, entité ou valeur existe ou possède telle propriété mais, par exemple, de savoir s’il est légitime de considérer que tel contenu constitue une raison épistémique de croire en l’existence de tel fait, entité, valeur ou propriété. On peut ainsi concevoir des communautés disposant de règles inférentielles différentes, voire même des sociétés qui hiérarchisent de manière différente des principes épistémiques semblables aux nôtres. Il est ainsi possible d’imaginer, pour reprendre un exemple cité par Boghossian, des individus pour lesquels, par exemple, l’expérience doit nécessairement, en cas de conflit, s’incliner face aux Ecritures Saintes et qui ne tolèrent aucune possibilité de révision de cet ordre de priorité : l’incommensurabilité (ou la différence entre eux et nous) concernerait alors non pas le contenu des normes épistémiques mais l’ordre de priorité lui-même des principes de justification. La question que pose Boghossian est alors la suivante : peut-on évaluer objectivement tel système cognitif et, par exemple, affirmer la supériorité épistémique de tel système sur tel autre ? L’auteur expose alors les raisons pour lesquelles on peut être amené à adopter une forme de relativisme épistémique – ce qui n’est par ailleurs pas sa position finale sur la question2.
Le dernier article de la section, de Miranda Fricker, porte sur un autre thème central en épistémologie sociale, à savoir le rapport entre l’autorité rationnelle et le pouvoir social : l’auteur refuse à la fois l’idée d’une extériorité totale entre l’analyse socio-politique et l’épistémologie (comme si la question du pouvoir n’entretenait aucun lien avec celle de la diffusion du savoir et de l’attribution sociale de compétence épistémique) ainsi que la thèse consistant à réduire toute pratique épistémique à une forme, non reconnue comme telle, de domination socio-politique (ou toute forme de savoir à l’exercice d’un certain pouvoir) – thèse qui demeure par principe incapable de donner un sens clair à la distinction commune entre, d’une part, l’autorité l’épistémique réelle et, d’autre part, l’autorité purement institutionnelle. Plus précisément, elle s’attache au problème des biais sociaux qui peuvent affecter l’attribution de crédibilité épistémique à certains individus, institutions, etc. du simple fait de leur pouvoir ou autorité sociale et qui sont, inversement, susceptibles de nous conduire à sous-estimer les capacités épistémiques de certaines instances ou individus pourtant compétents – ce qu’elle considère comme une forme d’ »injustice épistémique »3. Cette forme spécifique d’injustice permet de mettre en lumière ce qu’elle nomme la « discrimination épistémique » que peuvent subir les individus dont les attributs sociaux (par exemple le sexe, l’appartenance sociale, l’origine ethnique, etc.) ne sont pas considérés comme des indicateurs de compétence épistémique – ou sont même parfois clairement considérés comme des indicateurs d’incompétence.
Les problématiques abordées dans la seconde section, composée de textes de Lackey, Goldberg et Goldman, appartiennent au champ d’interrogation de l’épistémologie sociale interpersonnelle. Cette section porte plus particulièrement sur l’épistémologie du témoignage. A quelles conditions les croyances basées sur le témoignage sont-elles justifiées ? La confiance en la parole d’autrui porte-t-elle en elle-même sa propre justification ou dépend-t-elle d’autres sources de validation ou d’autorisation épistémique (comme la perception ou la mémoire) ? De même, la justification de la croyance aux contenus émis doit-elle se baser sur certaines données préalables en faveur de la fiabilité de leur source ? Ou bien doit-on considérer que le simple fait qu’un contenu soit intentionnellement émis nous donne une raison, certes défaisable, de présumer qu’il est vrai ? L’intérêt du texte de Goldberg est de renverser, en un sens, le problème et de se demander à quelles conditions nous pouvons être justifiés à croire que non-p du fait que, par exemple, nos sources habituelles d’information ne disent pas que p. Ainsi, nous pensons qu’il n’y avait pas d’armes de destructions massives en Irak parce que nous supposons (plus ou moins explicitement) que s‘il y en avait eu, nous en aurions été informés (par les médias, par exemple). Le fait de n’avoir jamais entendu que p constitue-t-il toutefois une raison suffisante de croire que non-p ? Cette réflexion pourrait permettre de reconsidérer le problème de la censure (ou de l’autocensure) et du silence auquel elle condamne certaines informations ou idées ainsi que celui de l’incidence sur la manière dont nous formons nos croyances de ce mutisme, intentionnel ou non, qui empêche certains contenus, hypothétiquement vrais, d’être tout simplement diffusés. Le texte de Goldman réfléchit, quant à lui, à la situation du novice confronté aux avis radicalement divergents d’individus légitimement reconnus comme experts. Que dois-je croire lorsque j’assiste, par exemple, à un débat au cours duquel se confrontent des économistes légitimement investis d’une grande autorité épistémique dont les constats et les propositions divergent radicalement ?
La troisième section, composée des textes de Feldman, Elga et de Kelly, concerne une autre branche de l’épistémologie interpersonnelle : l’épistémologie du désaccord. Elle porte sur les situations de conflits argumentatifs dans lesquels, contrairement au cas précédent, je suis engagé avec des individus que je considère comme mes « pairs épistémiques », c’est-à-dire avec des individus qui ont des capacités inférentielles égales aux miennes, qui ont été (ou sont) exposés au même ensemble de données que moi et dont l’effort intellectuel qu’ils ont fourni lors de la délibération doxastique les ayant menés à la position qu’ils soutiennent sur la question débattue est grosso modo égale à la mienne. Quel est le comportement doxastique épistémiquement le plus légitime dans de telles circonstances ? Dois-je m’en remettre à la parole d’autrui, persister dans ma croyance, ou bien suspendre par principe mon jugement ? Plus profondément, la question centrale semble bien être la suivante : peut-il exister des désaccords rationnels ?
Si la réponse à cette dernière question est positive, cette possibilité est-elle par principe circonscrite à certains domaines ? Que penser de ce qu’on appelle le « principe d’unicité », exposé dans le texte de Feldman (mais également, entre autres, par Christensen4), et qui consiste à affirmer qu’une même « situation évidentielle » (ou si l’on préfère, un même corps de données) ne peut rationnellement « prescrire » qu’un seul état doxastique. Selon ce principe, il n’existerait donc, face à un même ensemble de données et pour tout agent cognitif, qu’une seule croyance épistémiquement légitime ou qu’une seule manière possible de s’y conformer rationnellement – ce qui revient à nier, on le comprend, la possibilité du désaccord rationnel. On peut remarquer que des débats similaires ont surgi récemment à propos de l’enseignement de la morale laïque à l’école. Lorsque Ruwen Ogien pointe, dans Le nouvel observateur, la naïveté épistémologique qui consisterait à croire que la morale laïque apportera avec elle « une justification des règles les plus communes – celles qui nous disent de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas voler – par les principes de la pensée critique, et non par l’autorité d’un commandement divin » et voit, par conséquent, derrière cette proposition « l’idée que si quelqu’un réfléchit rationnellement, il adoptera nécessairement ces règles » (c’est moi qui souligne), il prend en un sens clairement parti contre l’application du principe d’unicité à la réflexion éthique et estime que l’exercice rationnel de la pensée critique chez différents individus peut mener à l’adoption de diverses morales laïques concurrentes.
Les quatrième et cinquième sections portent, quant à elles, sur des problématiques concernant respectivement l’épistémologie sociale collective et l’épistémologie sociale institutionnelle. Le texte de List concerne ce qu’on nomme la « théorie de l’agrégation des jugements » (c’est-à-dire la théorie concernant la manière dont les jugements de groupes doivent être formés à partir des jugements individuels des membres du groupe), certaines de ses difficultés, et compare entre elles différentes méthodes d’agrégation des jugements selon deux desiderata épistémiques : la rationalité et la connaissance. Pettit, quant à lui, tente de montrer comment certaines entités collectives ou, plus précisément, certains « groupes à objectif », peuvent non seulement constituer des sujets intentionnels, en vertu de leur aptitude à avoir un comportement doxastique rationnellement unifié (notamment de manière diachronique) mais également comme des sujets personnels, du fait de leur capacité à penser à la première personne, c’est-à-dire à délibérer – ce qui explique que l’on puisse les tenir pour responsables de l’irrationalité épistémique éventuelle de leurs positions et, par conséquent, les critiquer.
Enfin, la cinquième section, composée des textes de Laudan, Fallis, Sunstein et Zollman, est peut-être la plus stimulante. Tandis que le texte de Laudan constitue une approche épistémique du droit pénal (dont l’une des finalités centrales, en l’occurrence produire des jugements corrects, est de nature cognitive) et consiste à évaluer les normes d’admissibilité des preuves au cours d’un procès eu égard à cette même finalité, celui de Fallis s’attache à apprécier les vertus épistémiques d’un système qui implique un haut degré de collaboration ainsi que de division du travail intellectuel et dont la finalité est, également, explicitement épistémique : Wikipedia. L’auteur se livre ainsi à une appréciation de la fiabilité et de la fécondité de l’encyclopédie collective en la comparant notamment à l’encyclopédie Britannica. L’article de Zollman s’interroge, pour finir, sur les effets épistémiques du partage de l’information à l’intérieur de la communauté scientifique. L’échange d’informations accroît-il nécessairement le nombre de croyances vraies entretenues au sein de cette communauté et contribue-t-il, par conséquent, au progrès de la connaissance ? Est-il, autrement dit, nécessairement fécond d’un point de vue cognitif ? Dans quelles situations, si celles-ci existent, les scientifiques doivent-ilsrestreindre la diffusion des résultats de leur activité ? L’auteur montre, entre autres, que le fait que les scientifiques ne soient pas informés de certains résultats expérimentaux appartenant pourtant à leur champ de recherche peut avoir des effets bénéfiques d’un point de vue épistémique : dans certaines circonstances, une diffusion trop importante et trop systématique de ces résultats peut introduire une forme de biais collectif dans la recherche, c’est-à-dire inciter la communauté scientifique entière à focaliser son attention sur certaines erreurs initiales et, par conséquent, à surestimer l’importance et le poids cognitif de contenus faux.
Cet ouvrage constitue une introduction excellente à cette discipline, du fait, en partie de la grande clarté des articles. Ces derniers sont à la fois très clairs (malgré leur complexité), inventifs et très stimulants. Ils témoignent, de plus, des nombreux rapprochements possibles entre l’épistémologie sociale, d’un côté, et la philosophie des sciences, la philosophie de l’esprit, la philosophie de la religion ou la philosophie politique de l’autre.


