سميح القاسم
المد يــر العـام *****


التوقيع : 
عدد الرسائل : 3177
تعاليق : شخصيا أختلف مع من يدعي أن البشر على عقل واحد وقدرة واحدة ..
أعتقد أن هناك تمايز أوجدته الطبيعة ، وكرسه الفعل البشري اليومي , والا ما معنى أن يكون الواحد منا متفوقا لدرجة الخيال في حين أن الآخر يكافح لينجو ..
هناك تمايز لابد من اقراره أحببنا ذلك أم كرهنا ، وبفضل هذا التمايز وصلنا الى ما وصلنا اليه والا لكنا كباقي الحيونات لازلنا نعتمد الصيد والالتقاط ونحفر كهوف ومغارات للاختباء
تاريخ التسجيل : 05/10/2009
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 10
 | |  Austérité et prospérité en temps de crise Austérité et prospérité en temps de crise | |
 | google_ad_client = "pub-1591488516340780";/* 200x200, created 11/9/09 */google_ad_slot = "0032844167";google_ad_width = 200;google_ad_height = 200;google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);google_ad_client = "pub-1591488516340780";/* 200x200, created 5/22/09 */google_ad_slot = "0626022255";google_ad_width = 200;google_ad_height = 200;google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); | Mondialisation.ca, Le 17 novembre 2010
| CADTM
|
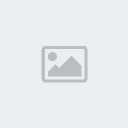 Envoyer cet article à un(e) ami(e) Envoyer cet article à un(e) ami(e)
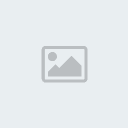 Imprimer cet article Imprimer cet article
|
« L’opinion doit apprendre à tolérer l’inégalité comme moyen d’atteindre une plus grande prospérité pour tous. »
Lord Griffiths, vice-président de Goldman Sachs, The Guardian, 21 octobre 2009. |1|
Les remèdes capitalistes administrés en temps de crise engendrent des défaillances débouchant sur de nouvelles crises. Celles-ci éclatent régulièrement, de plus en plus fréquemment sur tous les continents : au Mexique en 1982 puis fin 1994, en Asie du Sud-est en 1997-1998, en Russie en 1998, au Brésil en 1999, en Turquie en 2000, en Argentine en 1999 - 2001, aux Etats-Unis en 2000-2001, etc. Ainsi, se succèdent-elles les unes aux autres sans provoquer de changement structurel permettant d’explorer une voie radicalement différente. Bien souvent, les capitaux sont sortis juste à temps pour se mettre à l’abri à l’extérieur du pays et y sont rapatriés une fois le calme revenu. Les principaux détenteurs du capital en profitent pendant que les classes défavorisées subissent la crise de plein fouet.
A l’été 2007, le bateau prend l’eau…une nouvelle crise éclate et perdure encore de nos jours. A différent égards, celle-ci diffère des autres. Tout d’abord, la place géographique n’est pas anodine, elle survient aux Etats-Unis : c’est là que sont décidées les grandes orientations économiques mondiales à travers des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI (Fond Monétaire International), basées à Washington. Le « centre financier » (en opposition à « périphérie » ou « Tiers monde »), point névralgique où la principale place boursière donne la tendance jour après jour au reste du monde, est ébranlée. Ensuite, elle est systémique, multipolaire |2| : la crise de surproduction dans l’immobilier résidentiel aux Etats-Unis a provoqué la crise des subprimes. Celle-ci a produit une crise bancaire et financière de très grande envergure, qui en retour a affecté l’ensemble de la production dans les pays les plus industrialisés. Il s’en est suivi le recul le plus brutal enregistré depuis la seconde guerre mondiale. Si elles n’ont pas été affectées directement par la tourmente financière, les économies du tiers monde en ont ressenti les effets. L’Europe, touchée de plein fouet, est entrée dans une phase de crise profonde. Partout les gouvernements ont sauvé les banquiers et les assureurs en augmentant la dette publique. La crise économique est loin d’être terminée. Enfin, la crise écologique et climatique confirme l’incapacité du capitalisme à rendre une planète viable à long et court terme, non plus seulement pour nos descendants mais y compris pour les générations actuelles. Il en résulte une crise de confiance, existentielle où s’illustre la faillite du pouvoir politique incapable de relever les défis majeurs : notamment l’élimination de la pauvreté, la résolution des problèmes environnementaux, énergétiques et d’épuisement des ressources. On peut dès lors parler de crise de civilisation, ou systémique, tant les fondements de la société sont ébranlés.
Les répercussions de cette nouvelle crise systémique sont colossales : hausse du chômage, licenciements massifs, régression des protections sociales, des salaires, des retraites, explosion de la dette... En Europe, la réponse sociale ne s’est pas fait attendre et les grèves et manifestations ont éclaté en Grèce, en Roumanie, en Espagne, en France, au Portugal, etc. Parfois très radicaux, ces mouvements sociaux manquent cruellement d’unité et de coordination au niveau européen quand ils n’en manquent pas nationalement comme en Roumanie ou en Grèce. En effet, pour répondre à une attaque d’origine supranationale avec comme acteurs principaux le FMI et la Commission européenne, il conviendrait de mieux se concerter afin d’offrir une riposte à la hauteur de l’offensive. Seul un mouvement social déterminé et d’envergure européenne pourrait endiguer le cours des choses de façon salutaire |3|.
Même un empire bâti sur des mensonges pour partir en guerre au nom de la liberté ne peut résister à l’insurrection des peuples unis par la colère que suscite l’injustice capitaliste. Le totalitarisme des firmes multinationales érigé en système par le dogme du profit et le mythe de la croissance ne tient plus. Même repeint en vert, le capitalisme est destructeur. Prenons les choses au sérieux et commençons par arracher le mal à la racine de manière radicale (radical provenant du latin « radix » et « rhiza », racine en grec) afin de repenser l’économie au service de l’homme et non du marché.
Rapide retour sur l’origine et l’évolution de la crise actuelle (2007-2010)
La crise actuelle s’inscrit dans le prolongement d’une série de crises dont l’origine et l’épicentre se trouve aux Etats-Unis : Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale jusqu’en 2006, relève le taux directeur de la Fed (la banque centrale des Etats-Unis) de 1% le 25 juin 2003, à 4,5% (le plafond atteindra 5,25% le 29 juin 2006) le jour de son départ, le 31 janvier 2006 |4|. Les ménages, qui avaient été incités par des banquiers peu scrupuleux à emprunter pour devenir propriétaires de leur habitation, se sont retrouvés dans l’impossibilité de rembourser une traite démultipliée. La crise hypothécaire a éclaté en août 2007 avec la spéculation sur l’immobilier et ses subprimes, des milliers de familles ne pouvant plus payer leurs logements ont été jetés à la rue. Du fait des nombreuses saisies immobilières, on estimait en septembre 2009 à 3 millions le nombre de familles expulsées de leur maison aux Etats-Unis |5|.
Quand le contribuable sauve sa banque, la dette privée devient publique
Dans le sillage de l’éclatement de la bulle immobilière étasunienne, le système bancaire qui avait, lui aussi, largement investi dans ces subprimes et autres fonds spéculatifs vacille. Le plan Paulson aussi appelé plan Tarp ("Troubled Asset Relief Program") de 700 milliards de dollars est approuvé par le Congrès en octobre 2008. Il a principalement servi à injecter des fonds dans le capital des banques, à renflouer l’assureur American International Group (AIG) et à aider le secteur automobile. À la fin novembre 2009, 560 milliards de dollars avaient été alloués dans le cadre de ce programme alors prolongé jusqu’à octobre 2010 (celui-ci devait en principe expirer fin décembre 2009). Dans le sillage des Etats-Unis, l’Union Européenne annonce qu’elle va injecter 1700 milliards d’euros pour sauver le système bancaire de la zone euro et le Royaume-Uni 500 milliards de livres. Les gouvernements se succèdent alors pour partir à la rescousse des banques avec l’argent public. Le 13 octobre 2008, la France décide un plan de sauvetage des banques pour un montant de 360 milliards d’euros, dont 21 milliards d’euros ont été versés aux 6 principales banques privées |6|.
Comme le signale Fréderic Lordon, « L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) évalue à 11 400 milliards de dollars les sommes mobilisées par ce sauvetage. Soit 1 676 dollars par être humain... » |7|. D’une manière générale, on a assisté au transfert de la dette privée vers la dette publique pour sauver le système bancaire. Tout cela aux frais du contribuable. La population pauvre déjà pénalisée par une fiscalité injuste (TVA, impôts…) est par ailleurs la première vulnérable au chômage, à la chute du pouvoir d’achat ou aux licenciements. Mais faut-il croire que cela ne suffisait pas pour lui demander, in fine, de payer de sa poche pour renflouer un système défaillant ?
Contrairement aux volontés affichées des Institutions, la dette publique continue à augmenter et son remboursement creuse le déficit. Les cadeaux octroyés au secteur bancaire, souvent responsable de la crise, par l’Etat ont aggravé les comptes de la dette publique. Selon les données d’Eurostat publiées le 22 avril 2010, la dette publique de l’Union Européenne des 27 pays membres est ainsi passée de 58,8 % du PIB en 2007 à 73,6 % en 2009 |8|, soit une progression de 7 300 à 8 700 milliards d’euros. Cela représente une augmentation colossale de 1 400 milliards d’euros en 2 ans, soit, grosso modo l’équivalent du stock de la dette publique externe de tous les pays dit en développement (1 500 milliards de dollars US) hébergeant les trois quart de la population mondiale ; montant lui-même comparable au stock de la dette publique de la France d’environ 1 500 milliards d’euros.
De plus, le rôle spéculatif des agents financiers joue un rôle déterminant. Le marché menace les Etats en spéculant sur leur dette. Après avoir déclenché des famines monstres en influençant à la hausse les prix des céréales en 2008 (les émeutes de la faim se sont répandus sur la planète alors que nous passions la barre des 1 milliard d’êtres humains souffrant de malnutrition), les spéculateurs, désormais prêts à faire vaciller un Etat, se sont tournés vers un autre secteur plus riche en retour sur investissement : la dette dite « souveraine ». Cette oligarchie capitaliste, déjà épargnée par une fiscalité laxiste à son égard, peut poursuivre sa course aux profits dans un contexte de crise qui la touche finalement peu, et dont on évitera de lui faire porter le coût, les politiques d’austérité ciblant les classes défavorisées et moyennes en premier lieu.
En période de crise, les banques et assureurs renfloués par le contribuable s’octroient de scandaleux profits
La crise du marché hypothécaire dit des « subprime » qui a démarré à l’été 2007, a rapidement fait tomber quelques institutions de renom comme Northern Rock (nationalisée à la dernière minute sans doute avant de pouvoir à nouveau en privatiser les futurs profits), Bear Sterns (qui a perdu 17 milliards de dollars en moins de 48 heures), etc. Mais la crise n’affecte pas tout le monde de la même manière et certaines multinationales font des profits énormes. Exxon Mobil a ainsi battu les records en enregistrant un bénéfice net annuel de 41 milliards de dollars pour l’année 2007, le plus important jamais enregistré par une entreprise |9|.
Les grandes banques se sont retrouvées très exposées aux montages financiers douteux (on parle de « créances pourries », « Junk bond »). Mais malgré cela, dans un contexte de crise qui touche en priorité les petits ménages ne pouvant plus assurer leur logement, elles ont offert d’astronomiques bonus et autres avantages à leurs instances dirigeantes. En octobre 2007, en pleine crise des « subprime », Merrill Lynch (alors troisième banque d’affaires de Wall Street) a décidé le départ anticipé de son PDG, Stan O’Neal, non sans lui octroyer 160 millions de dollars de dédommagement (environ 30 millions en indemnités de retraite et 129 millions en stock-options). Voilà comment Merrill Lynch montre l’exemple en remerciant le premier patron d’une grande banque mondiale à endosser personnellement la responsabilité des pertes liées aux crédits à risque (« subprime »). Quelques jours plus tard, en novembre 2007, c’est au tour de M. Charles Prince, patron de Citigroup, d’être remercié avec un bonus de 12,5 millions de dollars. Le PDG de la banque Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, a quand à lui pulvérisé le record du bonus versé à un patron de banque, en se voyant récompensé d’un bonus de 68 millions de dollars en 2007 !
Deux ans plus tard, en 2009 donc, après avoir emmené leur entreprise à la faillite (perte record de 99 milliards de dollars en 2008), certains cadres d’AIG (American International Group) ont obtenu 165 millions de dollars de primes, alors que le sauvetage de l’assureur a mobilisé plus de 182 milliards de dollars de fonds publics. On peut affirmer par conséquent que la quasi totalité de l’argent public dégagée par les contribuables pour son sauvetage a ainsi été dirigé vers les cadres au minimum responsables de la faillite de l’entreprise sous forme de primes. Edward Liddy, président d’AIG s’était bien entendu défendu de la légalité de ces primes lors du scandale qu’elles ont occasionnées. Les dirigeants se sont servis avant que l’État fédéral récupère 80 % de l’entreprise en faillite.
Bonus aux fossoyeurs de Wall Street
Selon une enquête du Wall Street Journal, les principaux établissements financiers américains se seraient par ailleurs versé 130 milliards de dollars de rémunération (salaires et bonus) en 2007. Si l’on ne prend en compte que leurs bonus, les banquiers et courtiers de Wall Street ont perçu 33 milliards de dollars en 2007, chiffre astronomique au moment où les pays industrialisés entrent dans une profonde et durable crise. Ce montant n’est qu’en très légère baisse par rapport à une année 2006 record, lorsqu’ils s’étaient accordé plus de 34 milliards de dollars juste avant le déclanchement de la crise. L’année suivante, en 2008, les autorités de l’Etat de New York ont indiqué que les établissements de Wall Street ayant supprimé 19.200 postes en 2008, (soit une baisse de 10,3% des effectifs de l’industrie financière) ont versé 18,4 milliards de dollars de primes à leurs salariés la même année : même si ce chiffre est en baisse de 44% par rapport à l’année précédente (33 milliards), on licencie pour sauvegarder les bonus exorbitants de quelques uns. [Voir tableau ci-dessous]
Bonus et total rémunération (salaire et bonus) de Wall Street de 2006 à 2010 :
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Bonus Wall Street |
34,3 Mds $ |
33 Mds $ |
18,4 Mds $ |
20,3 Mds $ |
|
Variation % |
34 % |
- 4 % |
- 44 % |
+ 17 % |
|
Total rémunération |
|
130 Mds $ |
117 Mds $ |
139 Mds $ |
144 Mds $ (estimation |
Tableau réalisé par Jérôme Duval, 2010. Sources : New York City Securities Industry Bonus Pool, Thomas P. DiNapoli’s Office estimates State Comptroller ; Wall Street Journal
Ainsi, ces pratiques se poursuivent même après avoir bénéficié de l’argent de l’Etat pour se remettre à flot, au moment où le chômage et la précarité explosent en plein cœur de la crise. Cette explosion du nombre de chômeurs est particulièrement impressionnante aux Etats-Unis tout comme en Lettonie ou en Espagne qui détiennent les plus fort taux de l’Union Européenne, en Estonie ou en Lituanie. Dans son rapport, Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2009, Faire face à la crise de l’emploi, l’OCDE écrit : « De 5,6 % en 2007, son point le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage de la zone de l’OCDE est passé à 8,3 % en juin 2009, un niveau sans précédent depuis la guerre, le nombre de chômeurs ayant augmenté de presque de 15 millions. ». L’année d’après, le rapport 2010 de l’OCDE parle d’un « accroissement du nombre des chômeurs de 17 millions de personnes » depuis le début de la crise en 2007. |10|
Aux Etats-Unis, le taux de chômage officiel a doublé en deux ans, passant de 4,6 % en 2007 à 10 % de la population active au quatrième trimestre 2009 (OCDE). Selon Eurostat, près de 20 % des jeunes de moins de 25 ans étaient sans emploi en 2010 (19,6 % en avril), et le pays a perdu plus de 8,5 millions d’emplois depuis décembre 2007. Les 55,8 millions d’américains qui perçoivent une pension de la sécurité sociale, verront celles-ci gelées en 2010 pour la deuxième année consécutive, sans réévaluation par rapport à l’inflation.
Pendant ce temps, d’après le Wall Street Journal du 11 octobre 2010 |11| , les rémunérations des dirigeants de Wall Street se dirigent vers un nouveau record à 144 milliards de dollars pour 2010 et, inlassablement, le plus gros exportateur d’armes au monde accroît ses dépenses militaires : de 1998 à 2008, elles ont augmentées de 66,9 % pour s’établir à plus de 607 milliards de dollars en 2008. |12|. Contrairement à l’espoir qu’elle a suscité, et en dépit de la crise financière globale, l’administration Obama ne freine pas la tendance guerrière de son prédécesseur (Georges W. Bush avait réussi à augmenter de 63 % le budget militaire durant sa présidence, entre 2000 et 2008 |13|). À peine au pouvoir, l’administration Obama s’est accordée sur un budget militaire qui s’établit à 661 milliards de dollars en 2009, dont 65 milliards sont destinés à la guerre en Afghanistan où le Pentagone a doublé les effectifs militaires. Et on prévoit déjà que ce budget atteindra 719 milliards de dollars pour 2010 et 739 milliards en 2011. Sous la présidence Obama, ces dépenses ont atteint 43 % du budget militaire mondial en 2009 contre 41,5 % l’année précédente. Proportionnellement à la population, le budget militaire a dépassé les 2000 dollars par citoyen américain puisqu’en un an, il est passé de 1994 à 2100 dollars par habitant en 2009. Outre le fait de réjouir les multinationales du secteur de l’armement, la surenchère guerrière alimente la haine et compromet l’idée d’un monde de paix ; elle contribue par ailleurs fortement à l’envol du déficit public américain. Sur l’ensemble de la planète les dépenses militaires mondiales ont augmentées de 5,9% en termes réels par rapport à 2008 et de 49% depuis 2000 pour totaliser un montant estimé à 1 531 milliards de dollars en 2009. |14|
Les gouvernements discourent toujours
Le tout nouveau président des Etats-Unis s’était pourtant violemment emporté, le 29 janvier 2009, contre les primes versées par les groupes financiers américains à leurs salariés en 2008 : « Et ce qu’il va falloir entre autres, c’est que les gens de Wall Street, qui demandent de l’aide, fassent preuve de retenue, de discipline et de davantage de sens des responsabilités ». Malgré son appel à la « retenue », Obama n’a pas été bavard sur les 118 millions de dollars perçu sous forme de salaire, bonus et actions entre 1999 et 2008 par l’un de ses principaux conseillers, l’ancien responsable de Citigroup, Robert Rubin |15|. Pas bavard non plus sur celui qu’il a nommé au poste de secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, lorsque celui-ci avait « fraudé le fisc en dissimulant une rémunération qu’il avait perçu du FMI » |16|. Finalement, les beaux discours ne sont là que pour calmer l’opinion et détourner l’attention quand cela s’avère nécessaire.
En Europe, Nicolas Sarkozy s’était lui aussi emporté lors de son discours prononcé à Toulon le 25 septembre 2008 sans que cela change la donne. Faisant référence au trader de la Société Générale Jérôme Kerviel accusé d’une fraude historique de 5 milliards d’euros, il fustigeait alors, tout en paraphrasant – plutôt mal - Georges Marchais, « trop d’abus, trop de scandales » : « Ce système où celui qui est responsable d’un désastre peut partir avec un parachute doré, où un trader peut faire perdre cinq milliards d’euros à sa banque sans que personne ne s’en aperçoive, où l’on exige des entreprises des rendements trois ou quatre fois plus élevés que la croissance de l’économie réelle, ce système a creusé les inégalités, il a démoralisé les classes moyennes et alimenté la spéculation sur les marchés. ». Il est vrai qu’en termes d’inégalités il y avait de quoi crier au « scandale » puisque, sans même parler de parachute doré, selon le Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERCS), le revenu médian annuel des Français s’établissait en 2007 à 15 780 euros pour une personne seule et 23 664 euros pour un couple, lorsque le revenu moyen des responsables des plus grosses entreprises cotées au CAC40 se situait, lui, aux alentours de 5 millions d’euros. Nicolas Sarkozy n’avait pourtant pas hésité à « creuser les inégalités et à démoraliser » les français, classes moyennes comprises, en augmentant d’un coup ses revenus de 172 % en 2007. Le chef de l’Etat s’est-il par ailleurs scandalisé lorsque Patrick Kron, dirigeant d’Alsthom a empoché 12,2 millions d’euros de plus-values engendrées par la cession d’actions entre le 1er janvier 2008 et le 25 mars 2009 ? Quoi qu’il en soit, les beaux discours n’ont pas empêché celui-ci de bénéficier quelques mois plus tard de 4 millions d’euros supplémentaires lors de la cession d’actions d’Alsthom en novembre 2009. Le discours politicien relayé par les grands médias relève parfois d’une surprenante maitrise et il n’a sans doute pas été si aisé de passer de l’interdiction des paradis fiscaux, et de l’instauration de diverses taxes sur le système financier, à l’austérité budgétaire. Les Français avaleront-ils la pilule pour autant ?
L’avidité capitaliste mise en débat public
Au moment où le chômage et la précarité explosent, l’opinion publique s’offusque des bonus exorbitants versés à des dirigeants dont l’entreprise a été sauvée par l’argent du contribuable. Sous la pression médiatique et le scandale, John Mack, le PDG de la banque américaine Morgan Stanley aurait momentanément renoncé à son bonus ; Alex Miller, ancien administrateur délégué de la banque franco-belge Dexia a, lui aussi, renoncé en octobre 2008 à ses indemnités de départ de 3,7 millions d’euros. Josef Ackermann, dirigeant de la première banque allemande, la Deutsche Bank, après avoir encaissé près de 14 millions d’euros en 2007, en pleine tourmente financière, renonce lui aussi à son bonus « par solidarité » en 2008 et ne perçoit « plus que » 1,4 million d’euros de salaire cette même année. Ceci dit l’astreinte « solidaire » sera de courte durée puisqu’en 2009, il empoche un bonus de 8,2 millions d’euros qui, avec son salaire de 1,3 million d’euros, totalise 9,55 millions d’euros de rémunération. Le directeur de la Royal Bank of Scotland, Fred Goodwin, après avoir fait perdre à la banque 27 milliards d’euros en 2008 (24,137 milliards de livres), ce qui a amené l’Etat britannique a renflouer la banque à hauteur de 22 milliards d’euros (20 milliards de livres) pour lui éviter la faillite, a dû réduire de 212.500 livres sa retraite chapeau initialement prévue à 703.000 livres par an (soit plus de 800.000 euros). À l’âge de 50 ans, il s’était pourtant catégoriquement refusé à baisser la retraite qu’il touche depuis son départ en octobre 2008, ce qui avait déclenché la vindicte populaire et sa somptueuse demeure, située dans le quartier huppé de Morningside à Édimbourg avait été vandalisée en mars 2009. L’Etat a pourtant sauvé la banque en la nationalisant à hauteur de 84%. Depuis son sauvetage, 27.000 emplois ont été détruits par l’établissement bancaire dont la plupart en Grande Bretagne et la Royal Bank of Scotland annonce fin septembre, 500 suppressions de postes supplémentaires à Londres. (Les Echos, 29 septembre 2010)
Il serait trop long ici de dresser la liste des salaires, indemnités de départ et bonus attribués à l’oligarchie capitaliste en temps de crise, mais si tôt passé l’attention médiatique sur les rémunérations scandaleuses des grands patrons, ceux-ci s’empressent de rétablir les bonnes vieilles habitudes. Dans son rapport : Placer la reprise et la croissance sous le signe du travail décent, juin 2010, page 3, le Chilien Juan Somavia, directeur général de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) l’explique clairement : « En 2009, les gouvernements ont renfloué les institutions financières qui avaient provoqué le risque systémique – les fameuses banques « too big to fail ». Depuis, elles se sont remises ; notes, profits et primes sont en hausse, et le sentiment que les choses sont revenues à la normale règne sur les marchés financiers. »
Et, quand par peur du scandale, ils ne peuvent percevoir de trop grosses primes, les établissements financiers compensent le manque à gagner de leurs banquiers en procédant à des hausses significatives des salaires fixes. Arguant d’une concurrence effrénée, ils tentent de garder les meilleurs éléments sous leurs enseignes en augmentant les revenus variables ou fixes suivant les législations et charges en vigueur dans le pays concerné. « Si le climat avait été une banque, ils l’auraient déjà sauvé »
Cet empressement à sauver les banques est véritablement spectaculaire. La frénésie de nos dirigeants politiques était beaucoup moins visible lors de la crise alimentaire qui a augmenté de 150 millions en 2007-2008 le nombre de personnes affamées sur terre et a mis une vingtaine de pays en proie aux émeutes de la faim en 2008. Cet empressement à sauver les banques contraste encore avec l’apathie du sommet de Copenhague en décembre 2009 où l’on pouvait lire sur les murs de la ville et les affiches des manifestants ce constat, effrayant de vérité : « Si le climat avait été une banque, ils l’auraient déjà sauvé » |17|.
|
| |
|


